Ordre des mysticètes (11)
(baleines à fanons)
Les familles :
- baleinidés (3)
- néobaleinidés (1)
- eschrichtidés (1)
- baleinopteridés (6)
Ordre des odontocètes (69)
(dauphins, orques, marsouins, cachalots, ...)
Les familles :
- physeteridés (1)
- kogiidés (2)
- monodontidés (2)
- ziphiidés (20)
- delphinidés (33)
- phocoenidés (6)
- platanistidés (2)
- iniidés (1)
- lipotidés (1)
- pontoporiidés (1)
Généralités :
- Classification complète
- Anatomie
- Les sens
- Le SONAR des dauphins
- La pilosité
Les cétacés des côtes de France
Réglementation de la chasse aux cétacés
(n) = nombre d'espèces
Le grand cachalot
Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

Morphologie
 Les plus grands
mâles atteignaient 20,7 m de longueur maximum, mais depuis quelques
années, la taille maximale ne semble plus dépasser 18,5 m.
Les femelles plus petites mesurant quant à elles 12 m au plus.
Le poids varie également selon le sexe avec une masse de 45 à
70 t pour les mâles et 15 à 20 t pour les femelles.
Les plus grands
mâles atteignaient 20,7 m de longueur maximum, mais depuis quelques
années, la taille maximale ne semble plus dépasser 18,5 m.
Les femelles plus petites mesurant quant à elles 12 m au plus.
Le poids varie également selon le sexe avec une masse de 45 à
70 t pour les mâles et 15 à 20 t pour les femelles.
La tête impressionnante du cachalot représente plus du tiers
de la masse total de l'animal et plus du quart de sa longueur.
La peau du grand cachalot est grise sombre. La tête porte de nombreuses
cicatrices circulaires témoins des blessures infligées par les
ventouses des calmars géants capturés. La peau du reste du corps
à une apparence fripée.
Distribution
Les femelles et les jeunes vivent généralement dans les eaux chaudes équatoriales, tropicales et subtropicales. Les mâles en revanche ont une aire de répartition plus vaste qui s'étend de l'équateur aux pôles. Il est suggéré que les mâles se dévouent pour aller se nourrir dans les régions plus froides, laissant ainsi les femelles et les jeunes, plus sensibles au froid, bénéficier de condition de vie moins ardues.
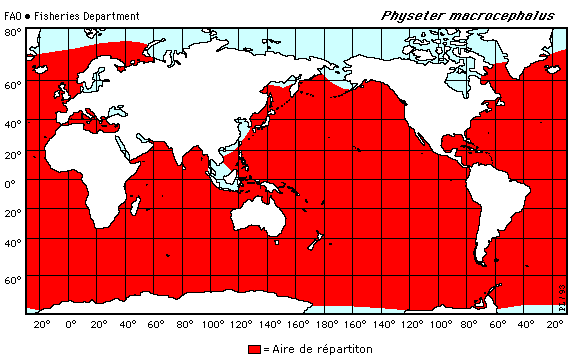
Alimentation
Le cachalot se nourrit à 80% de calmars atteignant parfois de grande taille (calmars géants : 12 m de long, 200 kg), le reste étant composé de poulpes, poissons et crustacés. Au cours de 4 "repas" par jour en moyenne, les cachalots mangent 3 à 4% de leur masse.
Une tactique de chasse du cachalot consisterait peut-être à rester immobile silencieusement à l'affût d'un banc de calmars passant à sa portée pour bondir dessus. La lumière étant quasiment totalement absorbée par l'eau aux profondeurs où il chasse, le cachalot ne pourrait pas voir ses proies si elles n'étaient pas luminescentes. La luminescence est en effet une caractéristique de la plupart des céphalopodes dont se nourrit le cachalot.
Mais la vue n'est pas indispensable pour la chasse dans la mesure où les cachalots détectent également leurs proies par écholocation. D'ailleurs, des cachalots totalement aveugles avec un estomac plein ont été capturés.
L'organe à spermaceti
Le cachalot se distingue par un énorme organe à spermaceti qui occupe presque entièrement le sommet de la tête.
Il s'agit d'une masse oblongue complexe de muscles et de tissu conjonctif contenant une substance huileuse, le spermaceti ou "blanc de baleine", contenue dans une membrane appelée réservoir. Chez les grands mâle, cet organe peut contenir jusqu'à 4 tonnes de spermaceti.
Le spermaceti change considérablement de densité avec la température.
Il sert à modifier la densité de la tête de l'animal de manière à :
- faciliter la descente,
- atteindre un état d'équilibre pendant la plongée,
- faciliter la remontée
et à canaliser ou concentrer les sons émis par le cachalot.
Régulation de la flottabilité
Tous les odontocètes ont des conduits naseaux asymétriques, mais ceux du cachalot sont particuliers :
Le conduit nasal gauche qui est le plus simple, part de la cavité située sous l'évent unique, contourne le côté gauche de l'organe à spermaceti avant de pénétrer dans le crâne. Le cachalot respire à travers ce tube musculaire qui peut se dilater.
Le conduit nasal droit est totalement différent. Il part également de la cavité située sous l'évent, mais se dirige d'abord vers l'avant du museau, où il forme une grande chambre, le sac vestibulaire. Puis il repart en un large tube aplatit qui traverse l'organe à spermaceti jusqu'à la boîte crânienne. Là, il forme un deuxième sac, le sac nasofrontal, avant de pénétrer dans le crâne pour rejoindre le conduit nasal gauche dans une cavité commune, la cavité nasopalatine.
Pendant la descente
En faisant circuler de l'eau dans le melon, les conduits nasaux, qui traversent
l'organe à spermaceti et les sacs vestibulaire et nasofrontal, pourraient
permettre de refroidir le spermaceti qui se solidifierait et se rétracterait
alors, augmentant ainsi la densité de la tête de l'animal pour
l'aider à descendre.
L'eau froide des profondeurs agit également extérieurement en
dissipant la chaleur de la tête du cachalot et donc du spermaceti.
En outre, les plus grosses artères et veines du melon du cachalot sont
disposées côte à côte ; ce système à
contre-courant favorise le refroidissement du spermaceti par échange
thermique car la chaleur du sang artériel qui arrive est partiellement
transférée au sang veineux, plus froid, qui repart.
Pendant la plongée
Afin de fournir un minimum d'effort pour se stabiliser à la profondeur désirée, le cachalot pourrait affiner la température de son spermaceti de manière à lui donner le densité idéale en régulant l'apport de sang artériel chaud dans les capillaires périphériques. Ainsi, un des rôles de l'organe à spermaceti est comparable à celui de la vessie natatoire de certains poissons.
Pendant la remontée
La circulation sanguine dans les capillaires du melon peut être accrue. Le spermaceti ainsi réchauffé voit sa densité diminuer ce qui aide le cachalot à remonter avec un minimum d'effort après chaque plongée. Les eaux chaudes de surface accroissent également le réchauffement de la tête du cachalot et donc du spermaceti.